Le Baubüro in situ a construit des locaux provisoires attrayants avec des conteneurs et des éléments de construction réemployés pour l’école cantonale à Uster. Des dalles de béton provenant de la construction d’un tunnel ont même pu être recyclées, explique Benjamin Poignon lors d’un entretien avec la rédactrice de Modulart Marion Elmer.

Bâtiment provisoire de l’école cantonale à Uster.
Images: Martin Zeller
Les conteneurs récupérés pour le bâtiment provisoire de l’école cantonale d’Uster en sont déjà à leur troisième cycle de réemploi?
Benjamin Poignon: C’est juste. Mais l’histoire a toutefois débuté sans le Baubüro in situ. Les conteneurs ont d’abord été utilisés pour un bâtiment provisoire de l’école professionnelle d’Uster. Le canton de Zurich a ensuite acheté un tiers des conteneurs et nous a mandaté pour les transporter à Winterthour où nous devions les ré-assembler pour construire un bâtiment provisoire sur trois ans pour l’école cantonale im Lee. Et quand il a été question de réemployer les conteneurs à Uster, le canton a de nouveau fait appel à nous.
Qu’est-ce qui est différent à Uster?
BP: Nous avons récupéré les conteneurs et les aménagements extérieurs de Winterthour. Comme le bâtiment provisoire de l’école cantonale im Lee n’a servi que trois ans, les exigences en matière de physique du bâtiment étaient nettement moins élevées que pour Uster. Ici, les conteneurs resteront en place pendant au moins dix ans et ont donc dû être adaptés en conséquence. Ils ont été équipés de toits mieux isolés, de façades ventilées et d’une zone climatique en amont.
Comment est née l’idée de la zone climatique?
BP: Les conteneurs sont très fonctionnels et ont été récupérés tels quels, seul le sol est neuf. Nous voulions donc offrir aux élèves et aux enseignants un petit bonus. Comme nous devions de toutes façons refaire les façades à neuf, l’idée d’utiliser l’une d’entre elles comme espace de transition entre l’intérieur et l’extérieur est née au cours d’une discussion avec le spécialiste en physique du bâtiment. Cet avant-corps n’est pas seulement une zone tempérée, c’est aussi un espace d’enseignement en groupes dynamiques.
Ne fait-il pas très chaud dans les conteneurs en été?
BP: C’était l’un de nos principaux soucis, et c’est la raison pour laquelle nous avons pris certaines mesures préventives. Comme déjà évoqué, la zone de transition tempérée permet de rafraichir et de ventiler en été, et de chauffer en hiver. Des cheminées d’angle sont situées à l’extérieur des avant-corps. L’air chaud monte par celles-ci et l’air frais peut se répandre. Des grilles sont installées devant certaines fenêtres afin qu’elles puissent rester ouvertes pendant la nuit et que les pièces puissent refroidir. En raison de la statique, il n’a malheureusement pas été possible de végétaliser le toit. Nous avons installé des supports pour plantes grimpantes en lieu et place sur les façades. Les plantes grimpantes s’enracinent dans le puisard situé devant les bâtiments, atteignant déjà le sommet au cours de leur première année.
Quand j’observe la carte des composants, je vois que de nombreux éléments constructifs ne viennent pas de Winterthour.
BP: C’est juste. Seuls les conteneurs et les couloirs ont été récupérés à Winterthour. Toutes les fenêtres, portes et lampes proviennent d’autres bâtiments. Les sols du rez-de -chaussée des avant-corps climatiques proviennent d’un tunnel provisoire de Walenstadt. Les dalles ont été armées avec des fibres et non pas avec de l’acier. Elles sont donc encore en très bon état, mais difficiles à recycler. Zirkular, notre entreprise partenaire, a réfléchi au meilleur moyen de réemployer les 2500 dalles du tunnel. Nous en avons finalement récupéré 50.
Seul le bois des zones climatiques est donc un élément neuf?
BP: Pas seulement. Les fondations et les sols en linoléum des conteneurs sont neufs, tout comme l’isolation de la toiture et des façades ventilées. Nous aurions bien aimé intégrer une pompe à chaleur existante, mais les scrupules du maître d’ouvrage nous en ont empêchés. Pour les installations photovoltaïques, nous avons presque réussi à réemployer des modules existants. Mais ça n’a finalement pas marché pour des questions de planning.
Comment fonctionne le processus de planification dans la construction en réemploi?
BP: Si l’on ne dispose pas d’un objet source en début de projet, on est contraint de faire des conjectures. Pour les façades des avant-corps climatiques, nous avions par exemple prévu un tableau que l’on pourrait remplir de diverses manières (voir graphique). Plus on est chanceux dans sa quête d’éléments constructifs, plus le tableau devient bleu. Moins on a de succès, plus il se remplit de cases rouges. A Uster, nous avons eu de la chance: nous avons pu récupérer des fenêtres de balcon à deux, trois et quatre battants d’un ensemble résidentiel à Zurich. Nous avons intégré les fenêtres à quatre battants au rez-de-chaussée, celles à deux battants au premier étage.
D’où viennent les panneaux des façades colorées?
BP: Ils viennent d’un toit de Frick et deux façades viennent de Wallisellen, plus précisément de Rotkreuz. Avec ces trois couleurs sous les yeux, nous avons eu l’idée de composer la façade en référence au bandeau de couleurs climatique.
Pour qu’un composant puisse être réemployé, il doit répondre à des exigences qualitatives. Comment cela fonctionne-il?
BP: Le physicien du bâtiment détermine les exigences requises pour un élément constructif: pour une fenêtre, ce sera par exemple la valeur U et l’isolation phonique. Quand Zirkular trouve des fenêtres, il manque peut-être la moitié des informations. Il faut donc faire ses propres recherches. Quand on sait de quand date un élément constructif, on peut faire des conjectures sur les exigences qu’il rempli. Mais si l’on ne trouve pas de renseignements, il faut faire des mesures.
Quand le réemploi vaut-il le coup, et quand pas?
BP: Il faut tenir compte de plusieurs facteurs. La question de la démontabilité revient sans cesse. Si l’on disposait de suffisamment de temps, on pourrait tout démonter. Mais cela ne vaut la peine que pour les éléments qui sont très chers à l’état neuf. Les éléments isolants, qui sont bon marché à l’état neuf, sont souvent collés de telle manière que cela n’en vaut pas la peine. Dans le cas des plaques de plâtre mastiquées, les traces de vis ont souvent disparu, ce qui rend leur réemploi plutôt délicat. C’est la raison pour laquelle il est si important de construire désormais d’emblée en tenant compte d’un futur démontage. C’est pour cela que quand nous utilisons de nouveaux éléments de construction, nous veillons à ce qu’ils soient facilement démontables et par exemple… à ce que les vis ne soient pas mastiquées.
Les projets de réemploi sont encore très marginaux. Est-ce que cela est en train de changer?
BP: Nous sentons que de nombreux maîtres d’ouvrage font tout ce qu’ils peuvent pour construire de manière plus durable. Mais quand on entre dans le concret, ça bloque souvent dans la mise en oeuvre. Est-on prêt à payer plus ou à renoncer à quelque chose? À mon avis, il faut encore un changement de perspective: il faut mieux reconnaître la qualité de l’existant. Quand on construit en réemploi, les éléments constructifs ont certes été utilisés auparavant, mais ils sont encore souvent de très bonne qualité. Il se pourrait même que l’on puisse profiter d’intégrer par exemple un sol en granit, qu’on ne pourrait pas se permettre à neuf.

Benjamin Poignon du Baubüro in situ.
Image: Martin Zeller
La personne
Benjamin Poignon a obtenu en 2014 un double diplôme d’architecture et de génie civil à Lyon (INSA-ENSA).
À Paris, il s’est spécialisé dans la construction circulaire et la réutilisation, acquérant ainsi des connaissances de base en menuiserie. En 2016, Poignon a fondé l’atelier « Bricologis » près de Lyon. Depuis 2018, il travaille pour le bureau d’études in situ à Zurich. En 2020, il deviendra membre du comité directeur du réseau suisse des composants de construction.
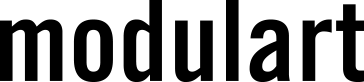




Écrivez un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs à disposition sont marqués par un *.